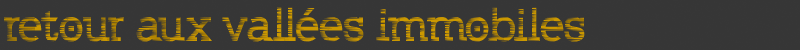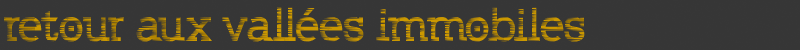Je suis issu d’une des plus vieilles familles des vallées immobiles. Je garde de mon enfance le souvenir d’instants uniques de calme et de liberté, entourés de denses forêts et de rivières s’écoulant vers des contrées inconnues…
Aussi loin que les souvenirs des anciens prennent racines, seul le vent froid des hivers blafards semblait rappeler aux talwegs des vallées l’existence d’un monde extérieur, d’un ailleurs.
J’écoutais parfois mon père me raconter comment nos trisaïeuls décidèrent d’isoler les vallées des désordres politiques du reste du pays. De ce récit aux mots atrophiés, comme on murmure à l’oreille d’un mourant, m’est restée la sensation d’un désastre à venir. Elle ne m’a jamais quitté depuis le jour où -étouffé par cette malédiction propre aux derniers-nés des villes sans âge- je laissais derrière moi les vallées immobiles.
Partout où mes pas me menèrent, leur souvenir me resta collé à la peau en une sensation oppressante. Infecté par la grande maladie de l’horreur du domicile, en fuite permanente, j’allais me brûler l’âme au contact des élites corrompues et de la plèbe lumineuse des villes anonymes. J’étais ce feu qui se déclare dans un champ de coton (La rumeur).
Quand le pays s’écroula définitivement, usé par des siècles de corruption, pourri de l’intérieur comme un os rongé par une tumeur, je sus que le temps du retour aux vallées immobiles venait de sonner.
Debout au sommet des vallées immobiles, j’écoutais le vent me murmurer l’étendue du désastre. Comme réveillé d’un long sommeil, je descendis petit à petit me plonger dans un passé révolu. Je franchis la porte des vallées comme on entre en son cimetière…